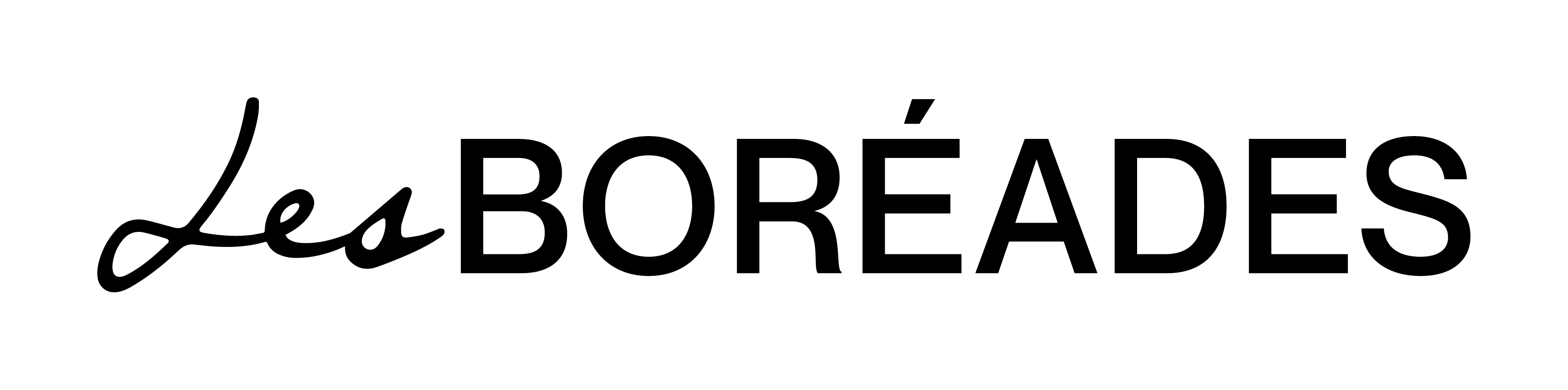Stromenti alla Veneziana
Avant-propos
Le 2e concert de la saison des Boréades, Stromenti alla Veneziana, sera présenté le jeudi 28 novembre prochain à 19 h 30 à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal. Ce concert est une coproduction Boréades/Fondation Arte Musica pour accompagner l’exposition vénitienne du MBAM, Splendore a Venezia. Nous rendons disponible préalablement au concert la note de programme rédigée par François Filiatrault qui accompagne le concert Stromenti alla Veneziana. Bonne lecture!
[vc_separator type=’small’ position=’center’ color= » thickness= » up= » down= »]
LA MUSIQUE INSTRUMENTALE À VENISE
De Gabrieli à Vivaldi
La première grande école instrumentale d’Occident.
Olivier Lexa, Venise, l’éveil du Baroque, 2011
[dropcaps type=’circle’ color= » background_color=’#005595′ border_color= »]L'[/dropcaps]invention de l’imprimerie musicale par Ottaviano Petrucci à Venise en 1501 allait marquer profondément l’histoire de la musique occidentale. En adaptant les procédés des caractères mobiles et de la presse à vis, déjà mis au point depuis quelques années pour l’impression des textes, Petrucci met la musique à la portée de tous en la faisant sortir des cercles privilégiés des églises et des cours princières – il n’est sans doute pas anodin que cette première démocratisation de la musique se passe à Venise, qui est alors, rappelons-le, une république. Le procédé se répandra plus tard dans d’autres villes en Europe, mais jusque vers 1700 les imprimeurs vénitiens publieront un nombre impressionnant de compositions dans tous les genres.
Cette nouveauté va grandement favoriser la pratique domestique. Comme en font foi de nombreux tableaux du temps, savoir la musique devient une nécessité sociale et procure un divertissement hautement prisé. Le fait également que leurs œuvres soient connues et appréciées par un grand nombre va rapidement contribuer à bonifier le statut social des compositeurs, qui seront bientôt aussi louangés que les peintres. Sur le plan strictement musical, les toutes premières publications de Petrucci vont familiariser les musiciens professionnels et amateurs avec les musiques savantes, particulièrement les chansons et motets polyphoniques des maîtres franco-flamands. Elles contribueront peu après à la formation des genres vocaux typiquement italiens, comme la frottola et le madrigal.
Mais, peut-être plus important encore, l’imprimerie musicale va présider à un développement exceptionnel des genres instrumentaux. Bien que toujours conçus dans un souci rhétorique, ceux-ci, n’étant pas directement liés à la signification ou à la prosodie des textes, amorcent une des tendances majeures qui caractérisent la musique occidentale : faire et écouter la musique en dehors de ses fonctions cultuelles ou sociales, pour le seul plaisir qu’elle procure.
Au départ, on joue aux instruments des partitions vocales, plus ou moins adaptées à ceux dont on dispose, puis on prévoit pour eux des morceaux autonomes. Ainsi naît la canzona da sonar (chanson à jouer). D’abord transcription de chansons parisiennes, genre dont Clément Janequin a donné les plus beaux exemples, la canzona instrumentale, tout en gardant certains traits de son modèle vocal – son début en rythme dactylique (une longue – deux brèves) et ses entrées fuguées –, connaît un magnifique développement, particulièrement avec Giovanni Gabrieli. Sous sa plume, la canzona, parfois polychorale et destinée principalement aux cornets à bouquin et aux sacqueboutes, prévoit des enchaînements de sections contrastées, avec des changements de rythme et de puissants passages homophones.
Gabrieli publie également une poignée de sonates, parmi les premières du genre. Certaines sont écrites pour un ensemble considérable – jusqu’à 22 voix –, mais sa Sonata a tre violini, parue en 1615, reste le coup d’envoi de la musique de chambre moderne et tire profit d’un instrument nouvellement perfectionné, le violon. Au départ, comme l’écrit Michael Praetorius en 1618, « les sonates sont pleines de gravité et de grandeur, analogues en cela au motet, [alors que] les canzoni, au contraire, faites de beaucoup de notes brèves, vont et viennent, toujours allègres, vives et rapides ». Mais, à peine une décennie plus tard, la canzona lui cédant graduellement la place, la sonate s’approprie ses caractéristiques et témoigne d’une grande ingéniosité créatrice, tout en convenant à un nombre plus restreint de protagonistes. À cet égard, demeurent exemplaires les sonates « in stilo moderno » que Dario Castello publie dans les années 1620 et qui auront un retentissement considérable. Constituées de sections en général enchaînées, elles captivent par leur ampleur, leur couleur, leur ingéniosité et par les pauses subites, les contrastes de tempos marqués, les passages virtuoses – certains prévus pour le basson – qu’elles savent ménager comme autant de surprises.
Détrônant le cornet à bouquin, le violon prend une place grandissante au cours du XVIIe siècle, et très tôt apparaissent les premiers virtuoses de l’instrument, qui seront également compositeurs. On apprécie la souplesse, les nuances dynamiques et l’extraordinaire virtuosité dont l’instrument peut faire preuve. On découvre également les caractéristiques acoustiques particulières qui résultent du fait de jouer à plusieurs violons par partie, phénomène au fondement de la notion même d’orchestre.
À partir des années 1680, la sonate se présente sous deux formes principales : la sonate en trio pour deux violons et basse continue, et la sonate pour violon seul et basse continue. Bientôt adaptée à tous les instruments, elle est dorénavant constituée de mouvements totalement séparés, influencée en cela par la suite de danses. Apparaissent alors les indications qu’on connaît encore aujourd’hui : Allegro, Largo, Andante… D’ailleurs, le mot de « mouvement » pour signifier une section indépendante renvoie à la danse : avec son rythme propre, chacune induit dans le corps de l’auditeur un mouvement spécifique.
Le concerto a une curieuse histoire. Le mot est d’abord employé, chez Gabrieli et Monteverdi par exemple, pour désigner une composition vocale avec instruments qui n’obéit pas à l’ancien et sévère contrepoint. Issu de la polychoralité, le style « concertant » se définit, en effet, par le dialogue et l’opposition de motifs mélodiques et de sonorités confiés à des protagonistes différents, dans une grande liberté formelle. Vers 1680 apparaît le concerto instrumental, c’est-à-dire qu’on dénomme alors « concerto » un genre qui exploite les contrastes obtenus par l’opposition d’un ou de plusieurs solistes à l’orchestre constitué par les membres de la famille des cordes, regroupés en quatre parties, soit deux de violons, une d’alto et une de basse – à l’époque, la contrebasse ne fait que doubler le violoncelle à l’octave inférieure.
Toutefois, de nombreuses imprécisions sémantiques demeurent – un Tomaso Vitali écrit même un Concerto di sonate –, mais ne sont-elles pas garantes de la liberté créatrice des compositeurs? Encore au XVIIIe siècle, on compose des sonates pour orchestre à cordes, tandis que se côtoient le concerto proprement dit, le concerto pour orchestre sans solistes, qu’on assimile à la sinfonia, et le concerto da camera, prévu pour un ensemble de solistes sans orchestre.
S’il n’est pas à proprement parler l’inventeur du concerto pour violon, c’est Antonio Vivaldi, lui-même violoniste exceptionnel, qui lui donne ses lettres de noblesse. Il lui confère sa forme définitive en trois mouvements vif-lent-vif et structure ses mouvements rapides en alternant tutti et soli : le soliste développe à trois ou quatre reprises le thème exposé d’abord par l’orchestre, celui-ci revenant périodiquement réaffirmer le matériau de départ, un peu à la manière d’un rondeau – c’est le concerto dit « à ritournelle ». Vivaldi adaptera ce modèle à tous les instruments de son temps, seuls ou en groupe. On doit sans doute cette remarquable diversité à la présence de plusieurs virtuoses parmi ses élèves de l’Ospedale della Pietà, l’orphelinat pour jeunes filles, peut-être le meilleurs conservatoire de Venise, où il était maestro di concerto (en charge des concerts).
À côté du violon, les instruments les plus prisés à l’époque, tant des amateurs que des professionnels, demeurent la flûte à bec, la flûte traversière et le hautbois, tous trois nouvellement perfectionnés par les Français. Quant au hautbois d’amour, un peu plus grave que le hautbois, il s’agit d’une invention allemande. Les maîtres vénitiens ne l’ont pas employé et on soupçonne que c’est à Dresde qu’Antonio Lotti a composé les quelques œuvres où il le met à contribution, alors qu’il y séjournait entre 1717 et 1719 pour y représenter ses opéras.
Revenant à l’imprimerie, une nouvelle technique de gravure sur cuivre développée en Hollande sonne, au tournant du XVIIIe siècle, le glas de l’imprimerie musicale vénitienne. C’est pourquoi Albinoni et Vivaldi, entre autres compositeurs, enverront leurs partitions à Amsterdam pour profiter de ce nouveau procédé, beaucoup plus raffiné et exact dans ses résultats.
Il est toujours fascinant de voir comment, au fil de l’histoire, les domaines les plus divers du génie humain concourent à la création de la beauté. Dans le cas qui nous occupe, sans vouloir établir une échelle de valeur ou statuer sur un progrès esthétique, l’imprimerie, la facture instrumentale et le développement des principes de la composition musicale ont agi à la fois indépendamment et conjointement, comme autant de parallèles croisées – excusez l’oxymore –, pour perpétuer ce qui semble bien être apparu dans la Venise de la Renaissance : offrir au plus grand nombre le simple et ô combien gratifiant plaisir de goûter la musique sous ses multiples facettes.