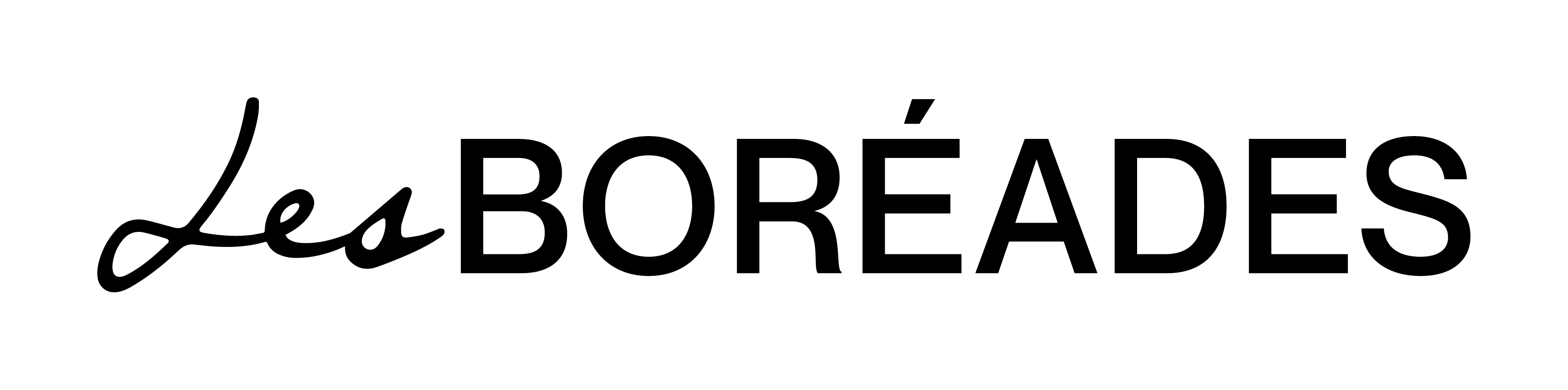Paris – Édimbourg: deux soirées musicales du XVIIIe siècle
Chers amis mélomanes,
Voici deux concerts en un! Suzie LeBlanc et Les Boréades nous convient en effet à deux soirées de musique fort différentes au XVIIIe siècle.
Transportons-nous d’abord dans un salon parisien quelque part autour de 1730, celui du financier Joseph Bonnier de la Mosson. En tant que trésorier général des États de Languedoc, celui-ci avait amassé une fortune considérable; bibliophile et grand amateur d’art et de science, il constitue en son hôtel de Lude, à Paris, un imposant cabinet de curiosités où figurent tant des spécimens de sciences naturelles que des objets relatifs à la chimie, la pharmacie, la physique et la mécanique. Plus important pour nous, il ne néglige pas la musique pour autant, disposant d’une importante bibliothèque musicale et d’instruments de prix, violons, clavecins et orgues de chambre. Sans compter qu’il patronne un temps les deux premiers compositeurs au programme de ce soir, Jean-Marie Leclair et André Chéron.

Jean-Marie Leclair
Jean-Marie Leclair, né à Lyon en 1697, se destine d’abord à la danse, mais après s’être mis à l’étude du violon avec Giovanni Battista Somis, un élève d’Arcangelo Corelli, il décide de s’y consacrer entièrement. Après être monté à Paris, Leclair publie en 1723 et 1728 ses deux premiers recueils de Sonates pour violon avec la basse continue, qu’il dédie à Bonnier de la Mosson. Il se fait bientôt entendre régulièrement au Concert spirituel, y remportant un grand succès tant par son jeu que par ses compositions, et il est bientôt nommé violon du roi. Mais sa nature ombrageuse, la difficulté de supporter ses rivaux, ou une circonstance inconnue, le font se retirer un temps en Hollande en 1737. Vers la fin de sa vie, mélancolique et misanthrope, il vit, séparé de sa femme, en banlieue de Paris et fréquente des milieux mal famés. En octobre 1764, il meurt assassiné par on ne sait qui dans le vestibule de sa maison…
Ennemi de la virtuosité gratuite, Leclair laisse une œuvre peu abondante, presque exclusivement instrumentale, toujours marquée d’élégance, d’ingéniosité et de sérieux. À côté de ses sonates pour violon, inspirées de Vivaldi et de Locatelli, ses deux Récréations en musique, publiées vers 1737 et prétendues sur leur page titre « d’une exécution facile », obéissent à une forme plus traditionnellement française : ce sont de vastes suites en trio, précédées d’une ouverture dans le style lullyste et comportant une chaconne de grandes proportions.
Assurément moins connu, André Chéron, né à Paris en 1695 dans une famille de musiciens, étudie d’abord avec Nicolas Bernier à la Sainte-Chapelle et sa carrière en sera une d’organiste et de claveciniste – il a aussi donné des cours de contrepoint à son ami Leclair. Vers 1729, il attire l’attention de Bonnier de la Mosson, et en 1734, il est engagé comme claveciniste à l’Opéra, dont il sera cinq ans plus tard le chef d’orchestre. On sait qu’il a composé des cantates et des motets, mais il ne nous reste de lui que ses Sonates en trio opus 1 et ses Sonates en duo et en trio opus 2, recueils dédiés tous deux à Bonnier de la Mosson. Chéron se moule dans la sonate italienne en quatre mouvements, mais amalgame la veine de Corelli aux danses typiquement françaises, dans une « réunion des goûts » tout à fait réussie.

Nicolas Clérambault
Les cantates avaient la cote dans les salons parisiens en ce premier XVIIIe siècle et celle de Nicolas Clérambault relatant l’épisode heureux de l’histoire d’Orphée comptait parmi les plus populaires. Né à Paris en 1679 lui aussi dans une famille de musiciens, Clérambault mène une carrière d’organiste dans diverses églises, dont celle des Grands-Jacobins, de Saint-Sulpice et de la Maison royale de Saint-Cyr, où il est protégé par Mme de Maintenon. Il a pourtant laissé très peu de musique d’orgue, se consacrant essentiellement à la composition de nombreux motets et de quelque 25 cantates, publiées en cinq livres de 1710 à 1726 et qui firent sa gloire.
Publiée en 1710 dans son premier livre, sa cantate Orphée met en scène un musicien mythique, celui dont les talents pouvaient selon la légende dompter les hommes, les bêtes, les dieux et même les végétaux et les pierres. C’est pour retrouver sa femme Eurydice, morte piquée par un serpent peu après leur mariage, qu’Orphée descendit aux enfers; s’accompagnant à la lyre, il réussit à fléchir la volonté de Pluton, obtenant la permission de ramener sa bien-aimée à la vie. Sans doute pour célébrer au premier chef la puissance de l’art des sons, l’œuvre de Clérambault ne relate que l’épisode heureux de la délivrance d’Eurydice, son propos s’arrêtant juste avant qu’Orphée ne la perde cette fois pour de bon, n’ayant pu s’empêcher de se retourner pour la regarder sur le chemin du retour, condition que lui avait imposée Pluton.
Une des plus dramatiques du répertoire et considérée tout au long du siècle comme un modèle du genre, Orphée, constate Catherine Cessac, « a plus fait pour la renommée de Clérambault que tout le reste de son œuvre ». D’une grande liberté formelle, sa structure et son harmonie sont tournées tout entières vers l’expression; en plus de dissonances audacieuses, elle emploie des tonalités rares à l’époque, passant par exemple, dans la supplique du héros, de fa dièse majeur à sol dièse mineur.
Déplaçons-nous maintenant à Édimbourg. L’Écosse est toujours restée très fière de son patrimoine musical, entretenu au XVIIIe siècle par nombre de musiciens de rue. Loin d’être méprisé, ce corpus de danses et d’airs divers fournira à la musique anglaise des tournures rythmiques et mélodiques fort originales. Des maîtres comme James Oswald ont aménagé plusieurs des mélodies écossaises les plus populaires dans les formes « savantes » de leur temps. Né à Crail, en Écosse, en 1710, Oswald apprend d’abord le violoncelle, puis travaille à Dunfermline comme musicien et maître de danse. Après une courte carrière à Édimbourg, il s’établit à Londres en 1741, et il sera appointé musicien de George III à son accession au trône vingt ans plus tard. Il ouvre une maison d’édition musicale et publie notamment d’importantes collections d’airs écossais, qu’il pourvoit de variations.
Plus encore, force est de constater combien les belles musiques des habitants de ces paysages de lacs, de landes et de bruyères ont su fasciner, à côté des musiciens locaux, de nombreux étrangers qui ont séjourné dans les îles Britanniques. À l’instar de leurs collègues, ils goûtent la vitalité des traditions musicales locales, la poésie des airs et la vigueur des danses populaires. Ils admirent l’habileté des musiciens du cru et ils se laisseront volontiers imprégner par cette sève nouvelle

Francesco Geminiani
Né à Lucques en 1687, Francesco Geminiani compte parmi les plus importants des élèves de Corelli. Après une série de concerts en Italie, il arrive à Londres en 1714 et se forge rapidement une réputation de virtuose et d’excellent pédagogue, obtenant la protection de plusieurs aristocrates. En 1733, il fait un premier séjour à Dublin, ville où il s’établit bientôt, y retournant après ses déplacements à Londres et à Paris. Geminiani publie en 1749 A Treatise of Good Taste in the Art in Music, dans lequel il présente de nombreux exemples de morceaux écossais suivis de variations de son cru. Dans sa préface, il défend cette musique contre les accusations « des professeurs grincheux » et rend hommage à David Rizzio, secrétaire particulier de Marie Stuart, qui avait deux siècles auparavant insufflé à une musique au départ « grossière et barbare […] l’esprit de galanterie propre à la nation écossaise »!
Son compatriote et ami Francesco Barsanti fera de même, mais au cœur même de l’Écosse, en publiant à Édimbourg en 1742 A Collection of Old Scots Tunes. Né en 1690, lui aussi à Lucques, Barsanti, flûtiste et hautboïste, débarque à Londres avec Geminiani en 1714, et il joue un temps dans l’orchestre qui, au King’s Theater à Haymarket, accompagne les opéras de Haendel. En 1738, il est engagé par la Edinburgh Musical Society, obtenant également la protection de Lady Charlotte Erskine, à qui il dédie ses « vieux airs écossais ». Mais l’institution connaît bientôt des difficultés financières et Barsanti regagne la capitale anglaise en 1743.
À la fin du siècle, le grand poète écossais Robert Burns, craignant l’affadissement que risquent d’amener ces diverses adaptations, exige dans une lettre de 1793 que le compositeur « ne change pas un iota aux airs écossais originaux [afin] que notre musique nationale préserve ses qualités d’origine ». Et il ajoute : « Elles sont, me semble-t-il, souvent sauvages et irréductibles aux règles plus modernes; mais de cette excentricité même dépend sans doute une grande partie de leur effet. »

Joseph Haydn
À la mort de son patron, le prince Nikolaus Esterhazy, Joseph Haydn peut enfin, à l’invitation de l’imprésario Peter Salomon, se rendre à Londres, où ses compositions font déjà sensation. Il y fera deux séjours heureux, en 1791-1792 et en 1794-1795, composant notamment une douzaine de symphonies, qu’il dirige avec un énorme succès. Il arrange également – « The Harmony by Haydn » – près de 150 chansons écossaise pour voix, violon et piano – nous ignorons cependant si elles eurent l’heur de plaire à Robert Burns…
Les musiciens qui ont travaillé dans les îles Britanniques au XVIIIe siècle ont tenté une sorte de « réunion des goûts » sérieux et populaire. Plusieurs ont apporté et cultivé le style baroque italien, puis le style classique allemand, au-delà de La Manche, mais ils se sont montrés très sensibles aux beautés des musiques locales.
© François Filiatrault, 2019
[vc_separator type=’normal’ position=’center’ color= » thickness=’3′ up= » down= »]
Le concert Paris-Édimbourg sera présenté le 19 septembre 2019 à la Salle de Concert du Conservatoire
LES BORÉADES ET SUZIE LEBLANC
[vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color= » thickness=’15’ up= » down= »]
[vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color= » thickness=’15’ up= » down= »]